….et plutôt se relier à la vie avec eux ?
Après plus d’une dizaine d’années à exercer sur internet, je n’ai qu’une idée floue et confuse de ce qui vous fait cliquer sur un contenu et y rester. Par contre, si vous êtes arrivé via Google c’est parfois plus clair. Ainsi, si vous venez d’une requête qui ressemble au titre de cet article, peut-être que vous en avez marre de trop jouer, peut-être que ça empiète sur votre existence au point de vous faire honte ou de vous détester. Peut-être que c’est autrui que vous considérez jouer trop, au point que ça vous inquiète pour son avenir.
Si vous venez des réseaux sociaux, il est possible que ce titre ait fait l’office d’un appât à rage et que toutes dents dehors vous vous apprêtez à défoncer un énième contenu psychiatrisant le champ des jeux vidéo ou les écrans.
Peut-être qu’au contraire, vous trouverez que c’est une excellente idée que de s’attaquer à ces foutus jeux-vidéo qui volent nos forces et temps de cerveau disponible, nous aliènent ou nous écervèlent et qu’il est grand temps d’arrêter de nourrir cette industrie aliénatrice qui empêche de s’atteler à la révolution1 ou de gaspiller son temps alors qu’on pourrait se consacrer à s’élever dans la société plutôt que stagner dans une basse classe2. Peut-être que certains d’entre vous diraient que les jeux vidéo ne sont tolérables que s’ils préparent, entraînent en mode simulateur à la guerre civile, voire « raciale »3.
Bienvenue à tous ! Ici il ne va pas s’agir de juger ni le jeu vidéo, ni les joueurs, mais de comprendre ce que dit la recherche sur le « surjeu », ses découvertes sur pourquoi il est qualifié de « trouble », comment il pourrait advenir et disparaître. On verra comment il a pu être « traité », notamment avec l’étude d’un camp de traitement en Chine et la sagacité d’un chercheur qui s’est intéressé avec un magnifique respect à ces surjoueurs.
Tout au long du dossier, il y aura des surprises et on découvrira des éléments très politiques de toute part, des éléments complètement sociaux et culturels, et finalement très peu « psychiatrisants ». Quitte à faire un spoiler, certains surjoueurs sont très conscients de ce qui se passe avec leur comportement, voire savent pertinemment comment faire pour changer les mondes non virtuels qu’ils fuient, contrairement à l’image infériorisée que les sociétés reflètent d’eux. Comprenant progressivement ce que cache vraiment ce thème de « l’addiction » aux jeux, on va découvrir ce qui permet d’avoir un rapport aux jeux beaucoup plus heureux, serein voire même des usages qui servent littéralement la vie. D’où le sous-titre que j’ai ajouté « ….et plutôt se relier à la vie avec les jeux/divertissements ? ».
Franchement, pour tout avouer, je n’étais pas très motivée au départ d’explorer cette question de « l’addiction » aux jeux que j’avais associée à des paniques morales de personnes ne connaissant absolument pas l’expérience des jeux. Mon mode débunkage était pleinement activé, mais les angles des chercheurs ont été beaucoup plus renseignés et fins que les échos des médias classiques s’alarmant de trop de jeux, d’écran, de divertissement.
Publier ce sujet en 2025 peut également apparaître complètement à la ramasse au vu des actualités dramatiques d’un fascisme aux USA, d’un génocide commis actuellement par Israël, d’un réchauffement climatique inquiétant et tant d’autres catastrophes que j’oublie. Les craintes écologico-numériques sont également ailleurs, notamment avec le sujet de l’IA qui anime tout le monde, donc il est décalé que je m’accroche à ce thème des années 90. Ou pas. De toute manière, l’exploration du sujet m’a offert des outils très étonnants, alors pourquoi ne pas les partager ?
J’espère que vous serez aussi étonné que je l’aie été et que cela puisse vous être utile pour mieux comprendre votre relation aux jeux et divertissements en général, ou celle qu’entretiennent les autres aux jeux, et comment s’autodéterminer collectivement avec tout ça pour faire la paix avec nos écrans ; voire mieux, qu’ils nous servent à plus qu’on ne l’aurait imaginé pour des thèmes sérieusement existentiels.
Pour l’instant, je vous propose cette petite exploration, qui se transformera en hyperlien au fur et à mesure des publications :
📂Tous les articles du dossier
1.Jouer, une drogue, vraiment ? (qu’on va voir ici même)
2.Qu’est-ce qui pousse certains à surjouer ?
3.Jouer pour oublier ?
4.Jouer en collectiviste ou en individualiste ?
5.Un camp de traitement pour « l’addiction à Internet »
6.Les darks patterns, une autre piste ? // Donc… ce qui fait le rapport empuissantant aux jeux…
X. Bibliographie
Jouer, une « drogue », vraiment ?
Dès qu’on commence à aimer quelque chose de façon obsessionnelle, à ne pas en décrocher, on a tendance à se dire « accro », « addict » et à le décrire comme une « drogue ».
Dans le langage psy et médical, on parle d’addictions liées à une « substance » et celle « sans substance » : par substances, on parle ici de drogues à effet psychoactif. Elles sont nommées ainsi parce qu’elles produisent chacune des phénomènes particuliers et puissants sur le cerveau, elles jouent avec sa chimie de sorte à désinhiber la personne, lui envoyer des hallucinations, la stimuler, la calmer. La personne consomme pour trouver ces effets très singuliers, qui sont, beaucoup plus intenses que le simple goût apprécié d’une grosse quantité de cheddar. Je ne sous-évalue pas le plaisir lié à ce fromage, mais le cheddar n’est pas psychoactif en principe et ne vous offrira pas une expérience inédite.
« Les substances psychoactives regroupent à la fois les drogues licites (tabac, alcool, opiacés, produits de substitution, médicaments psychotropes tels que hypnotiques, benzodiazépine, antidépresseurs,…) et non licites (cannabis, cocaïne, ecstasy, MDMA ou amphétamine,…). » https://www.has-sante.fr/jcms/p_3342082/fr/usage-des-substances-psychoactives-prevention-en-milieu-professionnel-note-de-cadrage
« Une drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable d’altérer une ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les communications neuronales. La consommation de drogues par l’homme — afin de modifier ses fonctions physiologiques ou psychiques, ses réactions physiologiques et ses états de conscience — n’est pas récente. Certaines drogues peuvent engendrer une dépendance physique ou psychologique. L’usage de celles-ci peut avoir pour conséquences des perturbations physiques ou mentales. Pour désigner les substances ayant un effet sur le système nerveux, il est plus généralement question de psychotrope. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue
Ainsi une substance psychoactive ou drogue n’entraîne pas forcément une dépendance physique ou psychologique, c’est par exemple le cas du pourtant très puissant LSD qui n’est pas addictif. Une substance psychoactive peut être légale comme illégale selon les pays et leurs époques et cette légalité peut changer. Par exemple, le LSD a été légal lorsqu’il a été découvert, les chercheurs se précipitant dessus y voyant une solution à quantités de troubles psycho, puis il a été rendu illégal, et depuis quelques années on redécouvre aujourd’hui des recherches à ce sujet parce qu’il pourrait faire un bon traitement à certaines doses, dans certaines conditions, pour certains troubles ou problèmes4.
L’effet de dépendance à des substances psychoactives, c’est lorsque la nature même de la substance et/ou sa façon de la consommer peut ne plus aboutir à l’effet recherché au bout d’un moment, car le corps s’y accoutume, puis il en vient à en avoir besoin (psychologiquement et/ou physiquement) pour simplement retrouver dans un état normal, et ce avec potentiellement des quantités qui augmentent de façon exponentielle. Au début, un expresso vous rendait tout fou et énergique, mais maintenant non seulement vous en avez besoin pour ne pas être complètement à la ramasse le matin, mais en plus il vous en faut 8 sur la journée, sans que ça vous surexcite.
Ainsi, il peut y avoir aussi une grande difficulté au sevrage, puisque le sevrage aura des effets physiologiques et psychologiques très difficiles, voire violents, donc décourageants. Par exemple, chez les grands alcooliques, arrêter brutalement l’alcool peut induire de forts délires dangereux, le delirium tremens, potentiellement mortel s’il n’est pas pris en charge.
Selon la substance, la personne peut vouloir vraiment arrêter, mais le sevrage est si insoutenable qu’elle la reprend pour arrêter de subir des symptômes très invalidants. Ainsi, dans ces addictions, la nature du produit est très importante à prendre en compte parce que le sevrage est totalement différent si on parle d’alcool, de café, d’antidépresseurs, de tabac ou d’héroïne, ce ne sont pas les mêmes pénibilités, risques, et donc les solutions sont différentes, y compris selon la hauteur de consommation de la personne, la singularité de la personne et le cadre dans lequel elle vit.
L’environnement social y compte énormément : si vos amis ne sociabilisent qu’à travers l’alcool, ne se voient que pour boire, qu’au boulot vous devez continuellement dîner avec des clients ou collègues qui vous incitent à boire, et que votre famille prend comme une offense le fait que vous refusiez de boire avec eux, la forte pression sociale qui se rajoute est un défi supplémentaire ajouté à la tâche de modération ou de résistance. En conséquence, se rajoute la peur d’être ostracisé, de perdre tout le monde, comme si la consommation était le passe-droit pour être ami avec ces personnes, les fréquenter. Peut-être que si on n’a connu que ça, on n’a pas appris à sociabiliser en étant sobre ou à relationner dans un milieu sobre. Tout ça rajoute de la difficulté au fait d’arrêter de boire. Il y a besoin d’un temps et de conditions suffisamment favorables pour supporter ou accompagner les symptômes : là aussi, les conditions que vit la personne dans sa société comptent.
L’addiction aux substances est donc fortement liée non seulement à la substance elle-même, mais aussi à notre rapport singulier et social à celle-ci : on peut se mettre à boire du café parce qu’on n’arrive pas à être aussi éveillé rapidement que les autres et donc y trouver une solution. Là où l’extraverti dès son réveil n’y verra pas d’intérêt puisqu’il est déjà en train de s’activer festivement dès 6 heures du matin.
Vous pourriez juste avoir attrapé cette habitude par conformisme et curiosité, à force de voir vos parents ou vos collègues de travail prendre une pause avec une tasse de café. La consommation de café a pu devenir une solution à une problématique carrément politique. Par exemple, si vous êtes dans un job pressant qui exige une vivacité dès 6 heures du matin et que vos boss vous hurlent dessus si vous n’agissez pas à 140 à l’heure parce qu’ils ont une politique capitaliste-autoritaire, le café va être saisi comme solution pour répondre à cette pression — et dans d’autres cas, ça pourrait être la cocaïne, qui est aussi psychostimulante, mais à une autre intensité. On pourrait aussi être né dans une culture qui a ritualisé la consommation de café dans un cadre spirituel uniquement5, cadre si rare que sa consommation n’entraînera pas de dépendance.
Vous pourriez avoir aussi goûté au café par curiosité puis d’emblée avoir eu une motivation intrinsèque au café, car vous aimiez son amertume et ses effets d’éveil, sans pour autant en avoir spécialement besoin ou que votre éveil caféiné soit exigé par la situation.
Or, le jeu-vidéo n’est pas une substance psychoactive.
Quand bien même il aurait des effets sur le cerveau, par exemple activer le circuit de réponse qui libère des neurotransmetteurs qui nous font du bien, c’est aussi le cas pour des centaines d’autres activités ou situations. Ainsi, ne vous faites pas avoir par les exagérations au sujet de la dopamine6 : ce n’est pas parce qu’une activité est liée à une libération de dopamine qu’elle est comparable à une drogue ou qu’on tomberait addict instantanément. Les neurotransmetteurs, tels que la dopamine, ont un rôle et des interactions très compliquées. En plus les individus peuvent avoir des particularités qui font que cette dynamique est très différente, pour des raisons de neuroatypie, de troubles, de génétique, voire d’âge. Le fait de simplifier l’analyse à « présence de dopamine = risque d’addiction ».
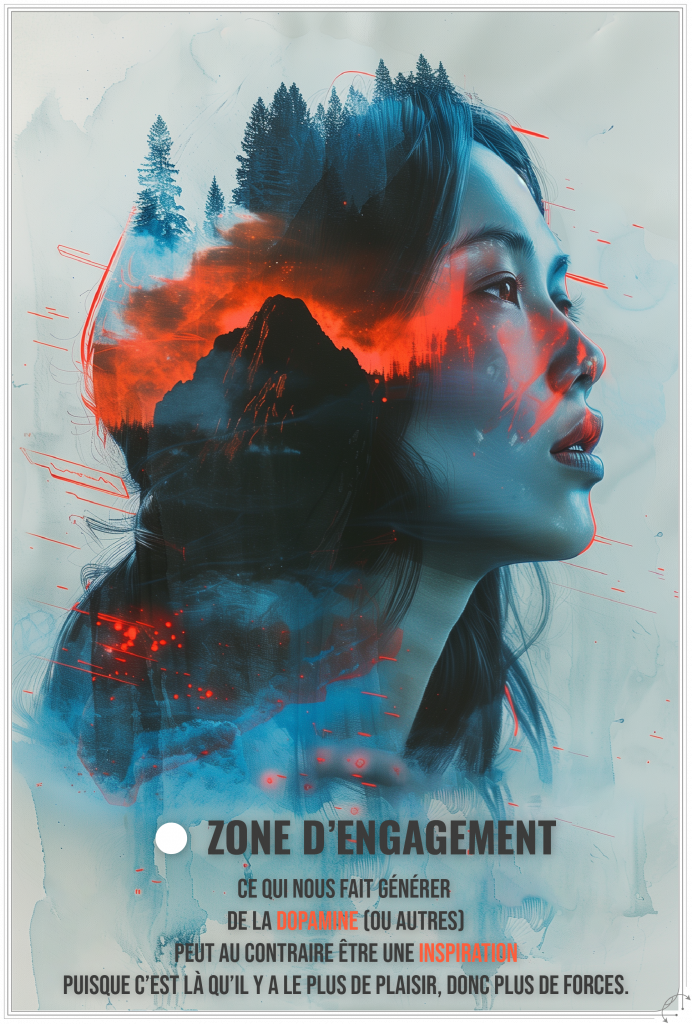
⬤ Zone d’engagement : Ce qui nous fait générer de la dopamine (ou autres) peut au contraire être une inspiration puisque c’est là qu’il y a le plus de plaisir, de motivation, donc le plus de mobilisation de toutes nos forces (là où un déficit, un manque rend tout plus difficile).
Parfois, les personnes manquent cruellement de plaisir et de joie en général, et si une activité en suscite, c’est plutôt une excellente chose qui appelle à s’en inspirer pour corriger nos environnements déprimants et désespérants qui tuent toute motivation à agir.

■ le plaisir comme poison : Croire que ce qui fait plaisir est forcément mal ou une drogue dangereuse qui va faire perdre tout contrôle
Ceci étant dit, oui il existe des addictions à des activités ou comportements qui ne sont pas des substances psychoactives. Le trouble du jeu d’argent est par exemple reconnu et renseigné depuis de longues années. Mais à l’heure où j’écris (en août 2025), il y a encore un fort débat sur l’existence ou non d’addiction aux jeux-vidéo, on parle plus volontiers de trouble du jeu-vidéo sur Internet ou d’usage pathologique du jeu-vidéo. Mais même ces appellations font débat, et certains articles scientifiques7 se demandent encore s’il y a réellement trouble ou seulement une panique morale.
Le trouble du jeu-vidéo a été néanmoins inclus dans la CIM (classification internationale des maladies, via l’ONU) et le DSM-5 (manuel de référence des troubles pour la psychiatrie), à cause de sa présence plus préoccupante en Asie, tout particulièrement en Chine et Corée du sud8.
La CIM caractérise ainsi le trouble du jeu vidéo :
« Le trouble du jeu vidéo est défini […] comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables.
Pour que ce trouble soit diagnostiqué en tant que tel, le comportement doit être d’une sévérité suffisante pour entraîner une altération non négligeable des activités personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles ou d’autres domaines importants du fonctionnement, et, en principe, se manifester clairement sur une période d’au moins 12 mois. » https://www.drogues.gouv.fr/loms-reconnait-officiellement-le-trouble-du-jeu-video-gaming-disorder
Le DSM 5 parle quant à lui d’« usage pathologique des jeux sur internet » et centre donc le problème sur les jeux en ligne :
« Utilisation persistante et répétée d’internet pour pratiquer des jeux, souvent avec d’autres joueurs, conduisant à une altération du fonctionnement ou une détresse cliniquement significatives. (…) N.B. : Ce trouble est distinct du jeu d’argent sur internet, qui fait partie du jeu d’argent pathologique. (…) L’utilisation d’internet pour des activités exigées par un emploi ou une profession n’est pas incluse ; le trouble n’inclut pas non plus les autres utilisations récréatives ou sociales d’internet. De même, les sites internet sexuels sont exclus ».
Dans le DSM, il est expliqué que ce n’est pas que les jeux hors ligne seraient sans dépendance, c’est juste qu’étant moins étudiés, ils ne peuvent pas l’affirmer.
Pour que cet usage pathologique soit reconnu selon le DSM, le psy doit voir chez la personne au moins 5 manifestations parmi ces propositions :
« 1. Préoccupation par les jeux sur internet (la personne se remémore des expériences de jeu passées ou elle prévoit de jouer ; les jeux sur internet deviennent l’activité dominante de la vie quotidienne).
2. Symptômes de sevrage quand l’accès aux jeux sur internet est supprimé (ces symptômes se caractérisent typiquement par de l’irritabilité, de l’anxiété ou de la tristesse, mais sans signe physique de sevrage pharmacologique).
3. Tolérance — besoin de consacrer des périodes de temps croissantes aux jeux sur internet.
4. Tentatives infructueuses de contrôler la participation aux jeux sur internet.
5. Perte d’intérêt pour les loisirs et divertissements antérieurs du fait, et à l’exception, des jeux sur internet.
6. La pratique excessive des jeux sur internet est poursuivie bien que la personne ait connaissance de ses problèmes psychosociaux.
7. Ment à sa famille, à ses thérapeutes ou à d’autres sur l’ampleur du jeu sur internet.
8. Joue sur internet pour échapper à ou pour soulager une humeur négative (p. ex. des sentiments d’impuissance, de culpabilité, d’anxiété).
9. Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des possibilités d’étude ou de carrière à cause de la participation à des jeux sur internet.
N.B. : Seuls les jeux sur internet sans mise d’argent sont inclus dans ce trouble. »
Ce qu’il faut savoir avec ce genre de liste, c’est que le psychiatre ou le psychologue ne va pas se contenter de compter le nombre de critères retenus pour statuer que c’est ce problème et pas un autre. En écoutant le patient, il va aussi faire attention au temps de jeu et ses conséquences psychosociales : Le DSM-5 précise que l’usage pathologique implique typiquement 8 à 10 heures de jeux par jour et au moins 30 h par semaine, et que les obligations habituelles comme l’école, le travail, la famille sont négligées. Dans certaines études de cas, les personnes à usage problématique du jeu peuvent faire jusqu’à plus de 16 heures de jeu par jour.
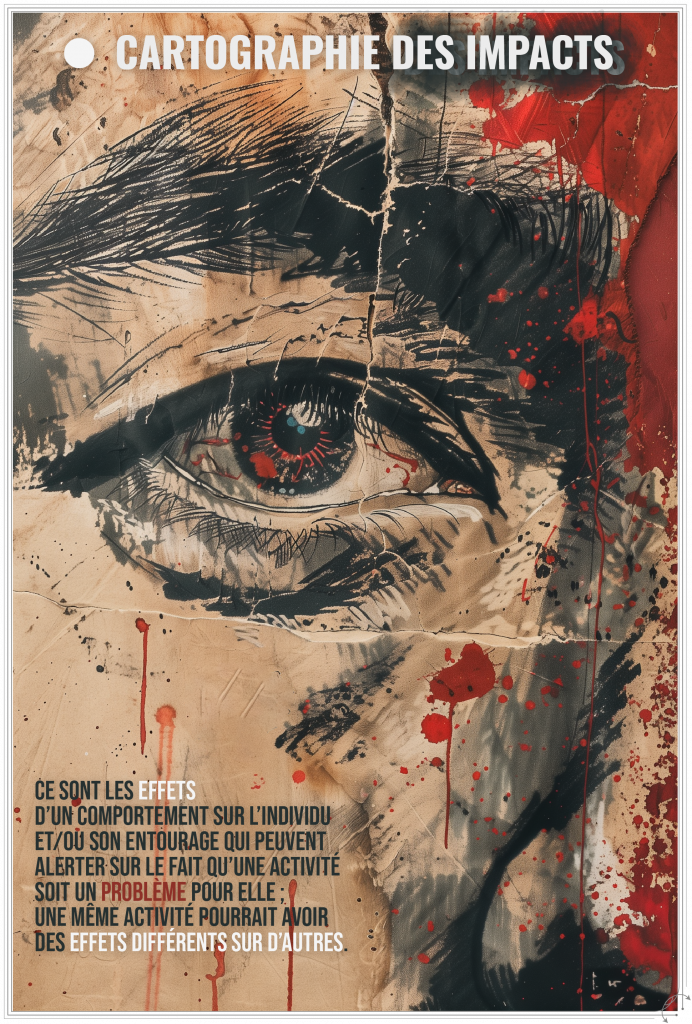
⬤ Cartographie des impacts : ce sont les effets d’un comportement sur l’individu et/ou son entourage qui peuvent alerter sur le fait qu’une activité soit un problème pour elle ; une même activité pourrait avoir des conséquences ou effets différents sur d’autres.
Autrement dit, une personne pourrait remplir plus de 5 critères pour Candy Crush, par exemple en y pensant beaucoup, étant irritée si elle ne peut pas y jouer, mentant à sa famille sur le fait qu’elle y joue, croyant qu’elle a un problème de jeu, et continuer quand même, même si ça entache ses relations. Mais si sa pratique n’était qu’une demi-heure dans la journée, que c’est parce que sa famille est hautement anti-jeu-vidéo que les relations sociales sont devenues mauvaises et qu’elle en vient ainsi à leur mentir, qu’en plus elle-même culpabilise en retour parce qu’elle a intégré un discours dogmatique anti-jeu, on n’aura pas un diagnostic de trouble du jeu. L’explication de cette pratique de jeu se trouvera peut-être dans l’expression d’un besoin irrépressible d’autonomie vis-à-vis de cette famille très contrôlante que cette personne a besoin de fuir. Peut-être que cette personne sent dans ce loisir singulier une façon d’être soi-même et plutôt que la pâle copie de proches, ce qui la pousse à jouer pour se sauver du contrôle autoritaire, même si une part d’elle-même n’a pas rejeté comme mauvais le contrôle autoritaire qu’elle applique ensuite sur elle en se culpabilisant, en se faisant honte, en croyant qu’elle a un trouble avec le jeu alors que son lien au jeu exprime une voie qui tente de la sauver du contrôle autoritaire.
Le bon psy verra au contraire qu’elle est victime de la dureté de son entourage et des normes injustifiées qu’on lui impose, que son temps de jeu est tout à fait raisonnable. Il pourra voir que le problème est davantage dans la panique morale des modèles contrôlants qu’elle-même a internalisée, au point de gâcher son temps de jeu raisonnable et d’être coincée dans deux mentalités qui se contredisent entre elles, l’une cherchant un divertissement souhaitable et l’autre attaquant cette recherche comme mauvaise.
Quand bien même on a ramené le DSM ici, il ne s’agit donc pas là de psychiatriser toute pratique du jeu, mais de voir quand celle-ci peut devenir problématique et être le symptôme d’un autre mal être plus complexe. Plus de 8 h de jeu par jour, hors pratique professionnelle, ça empêche de vivre quoique ce soit d’autres que le jeu. Et contrairement au travail qui est forcé d’être pratiqué à ces taux horaires, lui-même également affectant parfois aussi négativement les autres sphères importantes de la vie, il n’y a pas avec le jeu, d’obligation à jouer sous peine d’être viré. Jouer 8 heures par jour ne survient pas à ses besoins comme payer le loyer ou remplir le frigo. Donc pourquoi s’accrocher au jeu au point de tout laisser tomber, y compris des activités essentielles à la survie et au bien-être ?
La suite : Qu’est-ce qui pousse certains à ne faire que jouer aux jeux de leur vie ? [AJ2]
Note de bas de page
Déroulez pour consulter toutes les notes de bas de page et la biblio ↩️
La bibliographie complète est présente ici : Bibliographie [AJV]
L’image d’entête est issue de : How this Chinese « Quit Internet Addiction Center » abuse teenagers ) ( ! attention images violentes de vrais électrochocs dans un camp de traitement)
1 Vous aurez reconnu des critiques du jeu et du divertissement en général qu’on trouve chez une certaine gauche (par exemple dans le livre « divertir pour dominer »). À l’inverse, d’autres courants de gauche plus libertaires ont un discours différemment sur le fait de jouer, je pense aux situationnistes et plus récemment l’ouvrage Hyperjeu. L’éthique des hackers a tendance aussi à mettre la question ludique comme une bonne chose à injecter dans la désobéissance et la rébellion.
2 Et là c’est une critique du jeu-vidéo que l’on retrouve dans une droite bourgeoise estimant que le loisir doit servir l’élévation dans la société et ne surtout pas s’atteler à des divertissements populaires qui sont estimés creux ou ne permettant pas de remporter les faveurs de la haute société. On trouve cela dans les écrits d’Olivier Babeau par exemple.
3On retrouve cette critique dans une extrême droite suprémaciste, voire s’assumant parfois comme néonazie. Le forum stormfront par exemple contient parfois des discours anti jeu-vidéo parce qu’il faut se consacrer à sa « race » IRL prioritairement, dans l’augmentation de la domination ou dans la défense. Mais ils ne sont pas tous d’accord à ce sujet, certains utilisent les jeux pour assouvir leurs fantasmes suprémacistes ou corriger les jeux pour supprimer toute diversité, augmenter la capacité à massacrer des innocents ou autre. Le game design néonazi existe, mais même leur public néonazi semble se plaindre de la qualité médiocre des jeux ou de leur pauvreté, puisque le gameplay se réduit à massacrer des exogroupes sans autre possibilité.
4L’histoire du LSD est racontée dans « LSD mon enfant terrible » d’Hofmann ; pour les recherches récentes, on a ici par exemple quelques études qui s’interrogent sur le changement d’attitudes politiques ou de traits de personnalité (liés eux aussi à la question de choix politique) suite à l’usage de substances psychédéliques : https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.733185/full?mibextid=Zxz2cZ , MacLean, K.A. ∙ Johnson, M.W. ∙ Griffiths, R.R. Mystical experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin lead to increases in the personality domain of openness ;Lebedev, A.V. ∙ Kaelen, M. ∙ Lövdén, M. … LSD-induced entropic brain activity predicts subsequent personality change Hum Brain Mapp. 2016; Nour, M.M. ∙ Evans, L. ∙ Carhart-Harris, R.L. Psychedelics, personality and political perspectives ; Schmid, Y. ∙ Liechti, M.E. Long-lasting subjective effects of LSD in normal subjects. 2018; Erritzoe, D. ∙ Roseman, L. ∙ Nour, M.M. … Effects of psilocybin therapy on personality structure ; Erritzoe, D. ∙ Smith, J. ∙ Fisher, P.M. … Recreational use of psychedelics is associated with elevated personality trait openness: Exploration of associations with brain serotonin markers ; Lyons, T. ∙ Carhart-Harris, R.L. Increased nature relatedness and decreased authoritarian political views after psilocybin for treatment-resistant depression
5C’est juste un exemple imaginé, sachant que diverses cultures peuvent utiliser diverses drogues dans des cadres uniquement rituel ; par exemples les natifs d’amérique utilisait le tabac pour un usage médical et spirituel https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac_autochtone_en_Am%C3%A9rique
6La dopamine est un neurotransmetteur résumé souvent à une fonction de plaisir (or il ne fait pas que ça) et les réseaux sociaux se sont focalisés dessus à l’excès comme le montre très bien cette vidéo : https://youtu.be/jfU2KunUUUc?si=ThuOun-4pGkMvqsL
7 https://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp.2016.16121341
8La prévalence du trouble en Asie, pour les adolescents de 15 à 19 ans serait de 8,4 % chez les garçons et 4,5 % pour les filles. (Fu et al. 2010)

Bonjour et merci pour cet article !
Il serait intéressant d’explorer aussi les aspects de « alter ego » observés parfois. L’exemple typique est l’utilisation d’un pseudo de la mort qui tue « DemonMangeurD’ame666 » alors que la personnalité dans la vrai vie d’un tel individu est un parfais ange.
Merci pour votre analyse détaillée.