Sommaire de l'article
Profitons de cette rentrée, de ce renouveau annuel, plein de projets et de volonté, pour revenir sur une question qu’on nous pose souvent sur le blog ou via les commentaires de la chaîne Youtube Horizon :
« Au fait, le hacking social, c’est quoi ? »
Cet article est également disponible en PDF
Dès lors, nous avons le choix entre deux types de réponses, soit nous invitons notre interlocuteur à aller faire un petit tour sur l’à-propos du blog, soit on essaye, en quelques phrases, d’expliquer ce qu’est le Hacking social.
L’adaptation audio de l’article « à propos » par BB [vous trouverez un petit mot de lui à la fin de cet article] :
Pour autant, l’à-propos est parfois frustrant, car de manière générale, bien qu’apparemment compréhensible, celui-ci pose davantage un cadre plus qu’il ne définit spécifiquement le « hacking social ». Et quand nous essayons nous-mêmes de résumer ce qu’est le hacking social à un interlocuteur lambda, avec peu de mots, on peine à le faire, et cela se termine soit en un long exposé (loin de la simple définition ou du petit résumé demandé) ; soit en une formulation très courte, mais peu compréhensible pour notre interlocuteur qui ne voudra peut-être pas faire l’effort de la rendre intelligible ; soit en une définition pauvrette qui fait du hacking social un fruit sec sans jus à presser.
Alors, peut-on définir clairement le hacking social sans s’étendre sur plusieurs pages ?
Relevons le défi et essayons de le définir en une phrase:
Voilà, c’est fait, vous avez là un exemple de fruit sec !
Si le hacking social consiste à ouvrir le champ de possibilités, il paraît d’ores et déjà contradictoire de vouloir poser une définition close et univoque du hacking social.
À la définition du logicien, nous préférons des définitions souples et allégoriques, définitions équivoques pleinement ouvertes, multiples en reformulation, dans lesquelles chacun puisse naviguer selon son propre parcours, ses attentes, ses aspirations.
Il est donc préférable de privilégier une « définition souple » à une définition fermée.
De plus, quand on vient nous poser cette question « qu’est-ce que le hacking social ? », l’interrogation doit davantage s’entendre par « Concrètement, qu’est-ce que le hacking social ? Qu’est-ce que cela apporte ?». C’est ce « concrètement » qui est central, le questionneur ne demande pas tant une « information », mais en appelle à une praticité de ce que renvoient ces deux termes « hacking social ». À cette question, il est donc indispensable de répondre par des exemples. Mais là encore les exemples n’épuiseront jamais la question, d’autant que le hacking social se pratique selon les situations, le contexte du hack, et qu’en cela il n’y a pas de méthodes spécifiques et exclusives ou de formules « magiques » pour surmonter les problèmes rencontrés. Autrement dit le hacking social sera toujours à définir et à redéfinir, tout autant que les situations à partir desquelles le hacking social sera pensé et posé.
L’article que vous allez lire à présent est une réintroduction au hacking social, entendez par là que ce n’est pas une nouvelle introduction qui doit remplacer ce que nous avions écrit précédemment (tel que l’à-propos), mais qui vient compléter tout cela.
Pourquoi « Hacking » ?
Commençons par expliquer ce qu’est la mentalité et l’éthique du Hacker. Je vais vulgariser quelque peu le terme de hacking, excusez par avance mes raccourcis.
Le hacking est davantage une certaine mentalité, une attitude vis-à-vis de la réalité et des normes véhiculées, une éthique qu’on ne saurait réduire à de simples techniques.
Quelle est cette mentalité, quelle est cette éthique ?
Torvalds, le créateur de Linux, « définit » [il s’agit là davantage d’illustrer que de définir] le hacker comme un créateur, un bidouilleur. C’est-à-dire un individu qui cherche à comprendre un objet ou un système, qui le démonte, le répare, le détourne, le débride ; ou qui créé de nouveaux systèmes libres…. Le hacker expérimente, améliore, partage les découvertes et connaissances, ouvre des passerelles en vue de ce partage, mais aussi à destination de collaborations autour d’un projet, et tout cela sans motivation pécuniaire (en cela on peut d’ailleurs dire que les artistes, scientifiques et chercheurs, qui font de leur activité un plaisir sans que l’intérêt financier prenne le dessus, sont des hackers). Le hacker est mû par la libre activité et par le plaisir jubilatoire qu’elle engendre, et non par le profit ou l’intérêt matériel. On peut faire un parallèle avec le Flow exposé par Viciss dans cet article.
Dans L’éthique du Hacker, de Pekka Himanen, le hacker, par son activité, s’émancipe de la « valeur travail » et de ses normes.
« L’éthique hacker nous rappelle également que notre vie se déroule ici et maintenant au milieu de toutes ces tentatives pour minimiser l’individu et la liberté au nom du « travail ». Le travail est un élément de notre vie à travers laquelle il doit y avoir la place pour d’autres passions. Modifier les formes du travail est un sujet lié à la fois au respect des travailleurs, mais aussi au respect des êtres humains en tant que tels. Les hackers ne souscrivent pas à l’idée que « le temps c’est de l’argent », préférant affirmer « c’est ma vie ». C’est précisément cette vie que nous devons embrasser pleinement et pas une version bêta et creuse ».
Pekka Himanen
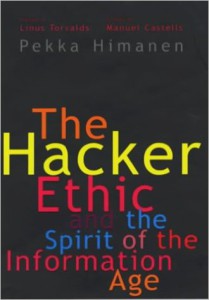 Le hacking est donc une invitation à l’autonomie et à l’autodétermination, à la création, au partage, à la collaboration : une activité qui consiste à ouvrir des possibilités et qui ne se fonde pas sur les valeurs « travail » traditionnelles.
Le hacking est donc une invitation à l’autonomie et à l’autodétermination, à la création, au partage, à la collaboration : une activité qui consiste à ouvrir des possibilités et qui ne se fonde pas sur les valeurs « travail » traditionnelles.
Eh bien, la mentalité du hacking social est similaire : il s’agit de comprendre les structures sociales dans lesquelles nous vivons, de les démonter, comprendre quels en sont les piliers, les interroger, identifier les déterminants sociaux, les stéréotypes, les attitudes normées, afin de les détourner, d’expérimenter, de les débrider si ces structures ou normes sont contraignantes pour l’épanouissement individuel et collectif (si ces structures « minimise l’individu et la liberté » pour citer l’extrait). Et tout cela se fait et se pense de manière ludique.
Pour donner une image, imaginons notre environnement social global comme un océan.
Le bateau qu’est le nôtre, c’est ce que nous n’avons pas choisi au départ : notre corps, les conditions socio-économiques actuelles, notre éducation, bref tous les outils dont nous disposons pour naviguer, notre situation en somme. Et il y a nous, en tant que capitaine du bateau, qui devons naviguer selon une orientation que nous nous donnons (ou que nous croyons nous donner). Nous naviguons sur cet océan, c’est notre espace. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, il y a des courants, des vents, des conditions particulières que l’on doit prendre en compte. Cela restreint notre champ de possibilités. Je ne peux pas, par exemple, aller à contre-courant, contre vents et marée, en maintenant une bonne vitesse. Je ne peux pas prendre les vagues de profil, sinon je risque de chavirer…
De plus, nous n’avons pas tous le même bateau. Nous n’avons pas choisi notre embarcation (nous n’avons pas choisi d’être homme ou femme, d’être né en tel lieu ou à telle époque, d’être né en bonne santé ou avec un handicap…), pas plus que nous choisissons les conditions climatiques. Bref, nous devons « faire avec », chacun partant d’une condition particulière avec sa propre singularité.
On peut se laisser guider par vents et courants qui peuvent être parfois favorables. On s’en remet alors à la bonne fortune. Mais à d’autres moments, ce courant peut être dangereux, plus particulièrement si notre bateau est fragile et si nous n’avons pas beaucoup d’expérience dans la navigation.
Le problème, c’est que, pour la plupart d’entre nous, nous ne savons pas naviguer, et, quand bien même, dès que nous sommes en zone de turbulence, plongés en pleine tempête, nous ne pouvons plus naviguer. Pire encore, nous nous bornons à croire que nous savons naviguer, que nous sommes maîtres à bord, alors que nous nous laissons entraîner par les courants.
Nous sommes comme cette fameuse pierre de Spinoza dans La lettre à Schuller : donnons une conscience à une pierre qui vient d’être jetée. Consciente de son mouvement, elle pensera alors qu’elle a librement choisi d’effectuer ce mouvement. Être conscient que nous allons dans telle direction ne signifie pas que nous avons librement choisi de nous diriger vers cette direction. Nous pouvons librement consentir à nous soumettre aux courants et autres déterminants, nous n’en serons pas plus indépendants.
 Le hacking social cherche à comprendre ces courants, ces vents, apprendre à colmater les brèches de notre bateau. À défaut de pouvoir changer les conditions climatiques, à défaut de pouvoir troquer notre barque contre un paquebot, nous pouvons apprendre à les utiliser à notre avantage. On peut apprendre aussi à repérer plus facilement les signes annonciateurs de tempête, ou annonciateurs d’un port non loin. On peut collaborer avec d’autres afin de cartographier des régions qu’il vaudrait mieux éviter, ou des régions plus propices. Pour le dire autrement, on ne peut pas, seul contre tous, changer le monde, contre vents et marées, mais on peut apprendre à y naviguer, éviter de tomber dans certains pièges, et nous libérer de certaines illusions comme la croyance du « je suis seul maître à bord », « je suis un libre sujet complètement détaché du monde qui pense et agit sans aucune détermination ».
Le hacking social cherche à comprendre ces courants, ces vents, apprendre à colmater les brèches de notre bateau. À défaut de pouvoir changer les conditions climatiques, à défaut de pouvoir troquer notre barque contre un paquebot, nous pouvons apprendre à les utiliser à notre avantage. On peut apprendre aussi à repérer plus facilement les signes annonciateurs de tempête, ou annonciateurs d’un port non loin. On peut collaborer avec d’autres afin de cartographier des régions qu’il vaudrait mieux éviter, ou des régions plus propices. Pour le dire autrement, on ne peut pas, seul contre tous, changer le monde, contre vents et marées, mais on peut apprendre à y naviguer, éviter de tomber dans certains pièges, et nous libérer de certaines illusions comme la croyance du « je suis seul maître à bord », « je suis un libre sujet complètement détaché du monde qui pense et agit sans aucune détermination ».
Le hacking social consiste à créer, proposer des outils, des clefs, des voiles pour naviguer plus facilement, plus sereinement, ouvrir un horizon de possibilités par la connaissance, par la pratique et le partage de l’art de la navigation. Éventuellement, le hacking social peut aussi proposer quelques refuges insulaires afin de permettre à chacun de respirer, de se « réapprovisionner », se ravitailler avant de prendre le large.
Quittons l’écume de cette analogie marine.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes à la fois plongés dans une certaine situation que nous n’avons pas forcément choisie ; mais, en même temps, dans ce cadre même, dans cette situation, s’ouvre à nous un champ de possibilités.
Merleau Ponty avait cette formule que j’affectionne :
« Naître, c’est à la fois naître du monde et naître au monde »
Nous ne sommes ni des êtres complètement libres, telle une conscience pure détachée du monde ; ni un être complément déterminé où il n’est même plus question d’envisager la liberté comme libre-volonté. Le sujet humain n’est pas un sujet clôt sur lui-même, détaché du reste du monde et pouvant s’autodéterminer sans peine, pleinement responsable de chacunes de ses actions. Le sujet humain est un sujet ouvert, un milieu qui ne saurait se comprendre qu’à partir de ses interactions. Ce n’est pas un noyau dur fermé, mais un nœud, un enchevêtrement de fils et d’éléments.
Autrement dit, le sujet est tout autant déterminé par son environnement que lui-même est un déterminant dans son environnement.
Le hacking social consiste à débrider le champ des possibles, notamment dans la compréhension de cette situation qu’est la nôtre (individuellement ou un groupe), et plus particulièrement dans l’appréhension des structures sociales dans lesquelles nous vivons et interagissons.
Structure et rapports sociaux
Dans l’à-propos, nous distinguions la structure sociale rationnelle de la structure sociale accidentelle. Cette distinction peut paraître artificielle, à juste titre, puisqu’on pourrait nous rétorquer qu’il n’y a pas une telle scission dans la société, le rationnel n’excluant pas l’accidentel, quand bien même cette structure reposerait historiquement sur de l’accidentel. Inversement, dans toute structure accidentelle, il y a des normes et des règles implicites, extérieures à cette structure, qui entrent en jeu. Alors, comment distinguer précisément structure rationnelle et structure accidentelle? Pour faire simple (sans faire simpliste), on reconnaît une structure rationnelle selon sa rigidité, et une structure accidentelle selon sa plasticité.
Pourquoi cette distinction est-elle si importante ?
Cette distinction est une distinction critique visant à délimiter le terrain d’action du hacker social et ainsi éviter toute confusion et dérive. On ne peut pas considérer de la même manière un groupe d’amis et un groupe de collègues au bureau. Dans les deux cas, un tissu se forme avec des rapports, parfois des règles tacites (même dans le groupe d’amis), etc… Pour autant, il y a une différence entre des rapports qui s’agencent accidentellement (entendez par accidentel ce qui n’est pas le résultat d’une opération calculée) et des rapports qui ont été pensés en vue d’un résultat précis, comme dans le monde du travail par exemple.
Dans un groupe d’ami, on ne va pas vous demander de vous habiller d’une certaine manière ; certes on choisit parfois ses vêtements en fonction du groupe dans lequel nous allons interagir, qui plus est un groupe d’ami, mais ces conventions tacites et suggérées sont souples et plastiques. Dans un groupe d’ami, je n’ai pas signé de contrat, je ne me suis pas engagé formellement, bien que je puisse m’engager affectivement. De plus, dans ce groupe, je ne calcule pas mes échanges avec mes amis, je suis capable du don et de la gratuité, je suis aussi capable de dépasser la réciprocité intéressée. J’ai souci de l’autre et mes attitudes à son égard sont bienveillantes. Bref, les rapports dans une structure accidentelle ne sont pas pensés préalablement sur la base du calcul, de l’intérêt ou/et d’un objectif extérieur. Cette structure est souple, vivante, c’est un tissu organique ; au contraire de la structure rationnelle qui est une machine mécanique.
Dans une structure rationnelle, c’est la fonction qui importe, non l’individu. Ce dernier est un rouage dans une grande machinerie, machinerie constituant elle-même un rouage dans une plus grande machinerie, etc… Une structure sociale rationnelle est une structure dont les rapports et l’articulation de ces rapports ont été préalablement pensés, calculés. Différentes normes et règles explicites et implicites régissent ces structures, rigidifiant et fixant les rapports. Le champ d’actions, et même de pensées, de l’individu est réduit à sa plus simple fonction. L’étiquette prime sur la personne. Par exemple, dans le monde professionnel, le travailleur est une « ressource », de plus ou moins grande importance selon l’apport que sera le sien dans cette machine qu’est l’entreprise. Les membres du groupe, fruit de ce type de structure, en viennent eux-mêmes à calculer leurs échanges (ceux qui ne le font pas, dans une structure rigide et compétitive, se feront écraser), ils sont incapables de penser la gratuité, le don (sauf si cela en appelle un retour d’ascenseur, dès lors ce n’est plus alors un don authentique). Il n’y a plus souci de l’autre, si ce n’est qu’en apparence ; la compétition l’emporte, l’autre devient concurrent, partenaire possible, mais uniquement si cela sert son intérêt. Le don devient vente, l’individu devient produit, l’épanouissement devient tout son contraire : la vente de soi (je vous invite à lire l’article de Viciss sur le « marketing de soi »), les fins poursuivies étant pour l’individu des fins irrationnelles par rapport aux finalités dans lesquelles il évolue. Nous aurons l’occasion de préciser cela ultérieurement. Nous envisageons en effet d’écrire un article ou une série d’articles, sur ces mutations structurelles hyper-rationnelles, fruits d’un rationalisme économique sans cesse grandissant depuis l’industrialisation à grande échelle.
Le hacker social n’aime pas ce qui est rigide, car antinomique avec la souplesse et l’élan humain. C’est cette rigidité cadavérique qui constitue ce terrain de réflexion et d’activité qu’est le sien. Car cette rigidité aliène l’individu, l’incitant à devenir cette étiquette accolée sur lui, à suivre des modèles, des moules, dans lesquels il déverse sa vie en espérant ne pas être trop cuit (« réussir sa vie !»). Tout cela repose sur des croyances anthropologiques et sociétales qui restreignent notre vision, restreignent nos mouvements, et font de nous des agents de notre propre servitude volontaire.
Par là même, le hacker social veille à ne pas confondre ce qui est de l’ordre de l’organique (accidentel), et ce qui de l’ordre du mécanique (rationnel). Pourquoi ?
Certes, dans toutes structures, même les plus souples et vivantes, on retrouve des normes sociales qui méritent réflexions, ce que ne s’empêchera pas de faire le hacker. Pour autant, quand le hacker social cherche à désamorcer des structures nuisibles, il doit lui-même être capable de calculer, de prévoir, d’anticiper, ne serait-ce que pour comprendre les calculs rigides sur lesquels il travaille. C’est un peu comme certains arts martiaux orientaux : on n’oppose pas une force contre la force de l’adversaire, on essaye de retourner la force que l’adversaire incline sur nous. Le hacker social est en quelque sorte, dans ce cadre, un « contre-manipulateur ». Or, dans une structure accidentelle, un contre-manipulateur, qui n’a pas à contrer de manipulations véritables, devient à son tour un manipulateur. Il calcule dans des sphères où il n’est pas question de calculer. C’est pour cela que celui-ci n’a pas à hacker dans des structures familiales ou amicales, on ne hacke pas des structures souples, car dès lors on participe à sa rigidité. On ne débride pas ce qui n’est pas bridé.
Pour autant, le hacker social peut tout à fait travailler dans ces structures souples. Après tout, il s’agit de son doux foyer, alors il ne travaille pas en tant que « contre-manipulateur », mais davantage en tant que créateur. Créateur de quoi ? De passerelles. Il créé des connexions, des possibilités de rencontres, toujours dans la visée de l’épanouissement individuel et collectif. Il veille d’autant plus à ce que ces passerelles soient souples et non rigides.
Le hacker social peut donc se définir, entre autres, comme un contre-manipulateur, mais il ne se réduit pas à cette « contre-manipulation ».
Dans son Discours sur la servitude volontaire, La Boétie forge cette célèbre formule :

Et une telle résolution n’est rien si cela n’implique pas une curiosité et une compréhension toujours renouvelées des différents leviers qui nous inclinent à cette servitude volontaire.
Le concrètement en fronton: quelques exemples
Le hacking social ne doit pas s’enfermer dans un discours éthéré. Il se veut praticable. Le hacker social doit veiller à ne pas s’enfermer dans ce que j’appellerai, et je m’excuse de ma vulgarité, une « masturbation intellectuelle », c’est-à-dire la construction d’un édifice intellectuel beau et séduisant en tant qu’édifice, mais impraticable dans les faits.
La pensée doit être praticable, tout du moins être un apport à l’agir. Wittgenstein disait :
« Tout ce qui est peut être dit peut être dit clairement, tout ce dont on ne peut parler on doit le taire »
De la même manière, je me permettrais de paraphraser le philosophe: « tout ce qui peut être fait, on peut le réaliser pleinement et concrètement, tout ce qui ne peut être réalisable, on doit y renoncer ».
Autrement dit, et pour reprendre l’image maritime précédente, il ne s’agit pas de changer vents et marées (ce qui serait illusoire, inaccessible à l’agir humain, et bien périlleux pour peu qu’on le fasse au nom d’un édifice céleste), mais plutôt de prendre connaissance de ces vents et marées afin de mieux y naviguer. Comprenez par-là que le hacker social s’intéresse à ces « petites choses » accessibles à son appréhension et à sa compréhension, à son pouvoir et à son vouloir.
Dans une structure sociale, quand quelque chose ne va pas, quand on veut changer les choses, on a tendance à regarder en hauteur: notre regard s’élève vers les sommets éthérés de la montagne, une montagne qu’on ne peut gravir. Pourtant, il suffirait qu’on abaisse un peu notre regard, qu’on renonce à cette prétention du haut (quand ce n’est pas la prétention qu’ont certains à détruire de leurs propres mains la montagne, prémisse des dérives en tout genre), ou qu’on renonce encore à se croire au sommet de la montagne contemplant la masse avec arrogance, et qu’on s’intéresse davantage aux petits cailloux à nos pieds. Là nous revenons modestement à un terrain praticable. D’autant qu’en adoptant cette perspective, on y appréhende d’une part plus aisément ces petits cailloux, mais on y découvre aussi parfois de bien jolies plantes qui attendent juste qu’on s’occupe un peu d’elle.
Nous allons donc donner quelques exemples, des petites anecdotes qui vous parleront peut-être, et qui nous parlent d’autant plus fortement qu’il s’agit de notre vécu, de ces « petits riens » qui ont d’une part leur importance, dont l’appréhension et l’emprise sont accessibles.
Les petits riens : exemple du vêtement
Il y a entre nous des rapports qui s’établissent, qui rendent possibles des interactions, ou les rendent au contraire impossibles. Et parfois, ce sont des petites choses, des « presque rien », des petits cailloux placés là, qui déterminent une hiérarchie dans les rapports et peuvent fausser les relations.
Exemple : la tenue vestimentaire.
Voilà la situation. Vous êtes salarié en restauration rapide (ça parlera peut-être à certains). On vous demande de porter un uniforme dépourvu de poche, parfois ridicule, avec un badge prénominatif.
Quelle en est la conséquence ? Il y aurait beaucoup de chose à dire, mais concentrons-nous principalement sur le badge vis-à-vis du client. Eh bien, par la tenue qu’on vous impose, vous pouvez devenir aux yeux du client comme un « produit » à disposition. Les rapports sont complètement faussés, le client connaît votre prénom, pas vous. Il peut vous nommer, pas vous. Vous perdez la liberté de vous présenter, la base même de toute interaction saine.
Alors vous allez me dire, ce n’est pas bien méchant, et c’est courant dans le monde du travail, plus particulièrement dans ces « petits » boulots étudiants (je mets « petits » entre guillemets, car cette expression de « petits » boulots est intéressante, comme justifiant des conditions très particulières auxquelles devraient se plier le salarié).
Certes.
Continuons cette mise en situation : imaginons que des clients, alors que vous portez le badge, (clients que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez sans doute jamais) vous interpellent par votre prénom en faisant leur commande:
« Hé Jean-Claude, je vais prendre un cheese burger… … ».
Cela ne vous fait aucun effet ? Cela peut très vite devenir humiliant, d’autant qu’à l’usage de votre prénom, le client sera lui plus à son aise (c’est là aussi le but). Par le badge on se sent mis à nu. Notre prénom n’est plus qu’une étiquette accolée sur notre torse.
Alors, vous allez sans doute ajouter, et à juste titre: « oui, mais de toute façon, sauf les rustres, aucun client ne nous appelle par notre prénom en lisant notre badge ». Tout à fait, ce qui me donne envie de poser une nouvelle question : pourquoi nous impose-t-on de porter le badge puisqu’il semblerait inapproprié qu’un client l’utilise à son bon vouloir ? Il s’agit de mettre à son aise le client, tout en intégrant symboliquement le salarié dans le moule de l’entreprise, lui ôtant une part de sa singularité. Le badge, l’uniforme, éventuellement les obligations d’avoir telle coupe de cheveux, participent à nous dépouiller de notre personnalité. On en est dévalorisé, on a le sentiment de perdre des possibilités, on se sent moins assuré en dehors de nos fonctions professionnelles, on rentre dans un moule.
Bergson disait (dans le Rire) que :
« Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous contentons de lire des étiquettes collées sur les choses »
De la même manière avec le badge, nous ne voyons plus que ce qui est utile, la fonction, et non la personne. Le prénom n’a pas plus de valeur que l’étiquette « confiture » accolé au pot de fruit écrasé.
Nous allons chercher loin me diriez-vous. Vous n’auriez pas tort tel et c’est pour cela que nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à lire un précédent article sur le port du badge, ou encore une vidéo d’Horizon, le premier épisode :
Par cet exemple, où veut-on en venir ?
Le port du vêtement, quand celui-ci est imposé dans une structure sociale particulière, dans le monde du travail ou dans une institution quelconque, n’a rien d’anodin quant à ses effets sur l’individu et sur les rapports sociaux, les distinctions qui en émanent. Le hacker social peut essayer de briser ces effets, cela peut se faire en rusant (si les normes en vigueur ne sont pas « négociables ») afin de court-circuiter ces normes, accompagner ses collègues et les inviter explicitement ou implicitement à comprendre par eux-mêmes ces biais. Et à défaut de briser ces normes factuellement (on ne peut pas toujours changer les normes, aussi absurdes soient-elle, quand les résistances sont trop fortes et aussi trop périlleuses pour l’individu ou le groupe qui évoluent dans ces structures), la prise de conscience du plus grand nombre peut réduire ces distinctions, amoindrir les violences qu’elles génèrent.
Le hacker social peut aussi s’approprier ces codes et normes vestimentaires et en jouer, casser l’univocité des codes. Le hacker est alors dans une démarche ludique et poétique. Il détourne.
Par exemple, les Yes-men, des activistes qui jouent avec les apparences et les codes, qui par le jeu parviennent à dévoiler des attitudes cyniques, usent de ces normes : un costume chic, une attitude particulière, et les voilà PDG, ou représentant d’une grande boite, décontextualisant les normes et faisant ainsi remonter ce qu’elles cachent.
Quand j’étais agent d’entretien
Quand on prend connaissance de cela, on peut faire des petites expériences.
Durant mes études, j’ai effectué, comme la plupart des étudiants, plusieurs « petits » boulots. Je m’occupais notamment de l’entretien des bureaux dans des entreprises, ou dans les cages d’escalier d’immeubles… On nous imposait des tenues, avec le gros logo de l’enseigne sur un polo tout moche.
Par chance, je n’avais pas derrière moi un responsable scrutant mes moindres faits et gestes, ce qui m’a permis de ranger au placard mon déguisement de carnaval, le troquant avec une tenue classique : jean, t-shirt et pull. Ce qui n’était pas le cas de mon binôme (oui, nous sommes en binôme quand on s’occupe des cages d’escalier, du moins là où je travaillais). Il y avait donc moi en tenue « classique », ou du moins en tenue non codifiée, et mon binôme en tenue de carnaval.
Il arrivait de temps en temps, et parfois même assez fréquemment, quand on nettoyait les cages d’escalier, que des résidents viennent se plaindre pour x raisons, à tort ou à raison, de la qualité de notre travail. Certains appréciaient déchaîner gratuitement leur frustration quotidienne sur les pauvres agents d’entretien que nous étions. Eh bien, quand un résident devait piquer une colère, c’était rarement sur moi mais sur mon binôme que se déchaînaient les foudres. Généralement, on m’évitait, alors que les personnes savaient très bien que j’étais agent d’entretien comme lui. Le résident ne nous connaissait pas, nous étions deux hommes du même âge, faisions le même travail, et pourtant c’était bien mon binôme qui récoltait les embêtements. Une fois, on s’est même adressé à moi de manière courtoise pour se plaindre de mon collègue, sur un travail que j’avais effectué avec lui, le résident pensant peut-être que j’étais son supérieur. Étrange! D’autant plus étrange qu’avant de ranger mon costume au placard, quand je portais la même tenue codifiée que mon partenaire, il n’y avait pas une telle distinction et je récoltais les mêmes critiques.
On s’aperçoit dès lors que ces « petits riens » codifiés altèrent les rapports. Je n’avais certes pas une tenue valorisante, mais par contraste avec mon partenaire vêtu ostensiblement de sa fonction, les résidents préjugeaient d’une part d’une certaine hiérarchie, et se permettaient d’autre part des remarques à celui qui d’apparence était « au plus bas » par rapport à l’autre. Ou alors, par le port du costume, on cessait de voir la personne, on y voyait l’entreprise, et dès lors on prenait moins de gants.
Des expériences en psychologie sociale viennent ajouter de l’eau au moulin. Vous en découvrirez une en image au début du deuxième épisode d’Horizon (l’expérience de Guéguen et Pascual) ou encore dans le livre « L’homme formaté ».
Je profite d’ailleurs pour signaler, par rapport à ma propre expérience, que le métier d’agent d’entretien est un excellent emploi pour s’entraîner au hacking social : on rentre partout, on voit les coulisses, on est invisible, on peut faire de la sociologie, étudier les groupes et les comportements, tester des biais, s’amuser à certaines expériences. Ça a été mon passe-partout pour entrer dans différentes entreprises, être dedans sans y être.
Exemples de structures rigides
Il y a des petits cailloux, mais il y a aussi de grands monolithes. Et là, les choses se compliquent. Nous parlons de structures sociales rationnelles. Pourquoi rationnelles ? Car ce sont des structures qui sont le produit d’une organisation intentionnelle régie selon des critères particuliers en vue d’objectifs précis. Cela implique aussi un certain calcul préalable consistant à fixer des rapports spécifiques.
Rien de problématique à cela, sauf quand ces structures sont intégralement pensées pour brider l’individu afin qu’il soit plus malléable, qu’il adopte un comportement spécifique, voire qu’il adhère à des valeurs contraire aux siennes.
Restons dans le monde du travail pour illustrer ce type de structure.
Il existe en effet dans le management des structures rationnelles préconçues sous forme de modèle que le responsable n’a plus qu’à fixer au sein de son entreprise ou de son groupe afin d’obtenir des effets précis. Citons en quelques-uns : Théorie des alliés, Benchmark, Lean management…
Prenons l’exemple du Lean Management, puisque c’est la « mode » en France depuis quelques années. Le Lean Management consiste à éliminer, dans l’activité du travailleur et dans l’organisation de l’entreprise, tout ce qui est superflu. Cela peut aller d’une lutte contre le gaspillage matériel (ce qui est une bonne chose), mais aussi une lutte contre déplacements et mouvements dispensables des salariés… Bref, on épure en quelque sorte le « gras », on retire ce qui ne sert à rien et qui fait perdre du temps, etc. Quand on fouille rapidement dans la littérature managériale, on nous vend le Lean comme une philosophie japonaise, le Kaizen, dont le principe est l’amélioration progressive et continue pour rendre les choses meilleures.
Séduisant, non ?
Pourtant, dans le merveilleux monde du management, le Lean management (d’ailleurs repris du Toyotisme) n’a rien de Kaizen. Le Lean pourrait convenir à l’artisanat, dans la quête de la beauté du mouvement, de la précision du geste, d’une perfection esthétique (on retrouve cela dans la calligraphie orientale, le geste vif, précis, élégant, sans fioritures). Adapté à l’individu, pour son épanouissement, on a là une sagesse tout à fait praticable et bienfaisante [c’est d’ailleurs là l’occasion de nuancer avant ce qui va suivre : le lean peut, s’il va dans le sens de l’épanouissement de chacun, s’il est pensé continûment, être un bon critérium à l’activité humaine, à condition qu’il ne devienne pas exclusif et dogmatique ; certaines entreprises sont parvenues à adapter le lean de manière intelligente et humaine, loin de la description que nous allons faire ci-dessous]. Mais adapté à une structure sociale, une organisation dans une grande entreprise par exemple, où l’amélioration continue n’est plus assimilée à l’épanouissement de chacun, mais à des objectifs de production, ce n’est plus du tout la même chose. On entre de plain-pied dans une optimisation machinale qui ne régit plus seulement les tâches, mais aussi les gestes et comportements. Les travailleurs, à toute échelle, participent eux-mêmes à cette optimisation. Là encore, on pourrait trouver très bien que ces derniers soient impliqués dans un tel processus. Oui, mais les travailleurs sont avant tout impliqués dans l’élaboration de leurs propres instruments de servitude, ce type de management les incitant à être leur propre surveillant pénitentiaire. Par exemple, certains gestes et déplacements seront prohibés, car inefficaces, perte de temps, et donc de productivité. Sauf que ces gestes superflus sont essentiels pour la santé physique et mentale de l’individu. On le sait tous pour l’avoir expérimenté : quand on doit répéter une même tâche, on a besoin parfois de varier les gestes, de faire des déplacements inutiles, tout simplement pour casser un peu ces mouvements machinaux qui, à force, sont non seulement éprouvant pour le corps, mais aliénant aussi pour l’esprit. Le Lean Management devient alors un prétexte pour mesurer, calculer, chronométrer, la moindre petite tâche, réduire les possibilités au nom de la performance. Les TMS (troubles musculo-squelettiques) augmentent, le lean devient prétexte à la surveillance et légitime parfois un véritable harcèlement institutionnalisé. Voilà un exemple de structure rationnelle rigide ; rigide, car elle fixe un cadre dans lequel il est difficile d’en sortir.
Le hacker social aura alors pour tâche de minimiser de l’intérieur (en tant que salarié dans l’entreprise qui pratique ce type de management, car rappelons le, le hacker social agit au possible de l’intérieur, et en toute discrétion) les effets nocifs du Lean. Là on entre dans le Hack. Dans la situation du Lean, le hacker social peut par exemple s’assurer de préserver un peu de « gras », réintégrer le superflu, par des petites touches précises dans son comportement, par ses rapports avec ses collègues et supérieurs, et par des discussions qui doivent progressivement amener l’autre à prendre conscience de la mécanique infernale dans laquelle il est plongé. Il ne s’agit pas de dénoncer, de grimper sur une table en criant bien fort que tout ceci est intolérable et absurde. Non, le hacker social agit un peu selon la méthode socratique qu’est la maïeutique : il amène peu à peu l’autre à saisir par lui-même les mécaniques dans lesquelles il est englué ; il accompagne l’autre afin qu’il puisse lui-même créer ses propres outils et instruments. Ajoutez à cela un peu de jeu et de ruse, et il est possible alors de court-circuiter, débunker, de telles mécaniques, tout du moins d’amoindrir ses effets.
Bisounours ou brutaliste ?
Le hacking social consiste aussi à nous défaire de nos lunettes négatives et déformantes de la réalité. Il ne s’agit pas d’adopter une vision du « tout joli tout beau », mais davantage d’éviter de tomber dans ces deux pans caricaturaux du « tout va mal » ou du « tout va bien ». Le hacker social doit apprendre à voir le meilleur sans dénier ce qui ne va pas. Chaque situation est un terrain riche en possibilités (et quand une situation est pauvre en possibilités, il doit lui-même créer de nouveaux embranchements, même les plus inattendus), le hacker cherche autant que possible à déplier ses possibilités et tendre à leurs actualisations.
Le hacking social implique donc une réflexion sur tous ces éléments qui réduisent notre champ de vision, tels que les stéréotypes, préjugés et tout autre prêt-à-penser. Il s’agit d’une démarche généalogique : on remonte le fil, on cherche les sources, les corps, tout en préservant le complexe et l’organique. On essaye de saisir le sens, ou à comprendre l’absence de sens. On interroge la langue, les expressions à la mode…
Exemple : le mot « bisounours » qui est devenu en peu de temps une insulte redoutable dès lors qu’il s’agit de décrédibiliser un individu ou de fuir un débat.
Quand on gratte un peu, on remarque que l’usage d’une telle insulte est très significatif, en dit long sur notre société. Qu’est-ce qu’on veut dire finalement par bisounours ? Par bisounours, on désigne des hommes ou des femmes « naïfs ». Est-ce tout ? Non, bisounours ne désigne pas seulement l’individu naïf, mais l’individu naïf parce que bien intentionné. Là est le problème, la bonne intention est devenu signe de faiblesse, pour ne pas dire dangereuse. Le bisounours, celui ou celle qui veut faire les choses bien, en respect d’autrui, est un faible.
On le voit dans les médias (en dehors des débats entre politiciens, entendons-nous bien, puisqu’il faudrait encore préciser le sens du mot dans ce contexte): quand on nous présente des individus doux, bien intentionnés, qui ont des visées humanistes, altruistes, et qui s’appliquent concrètement à mettre en œuvre des alternatives, ils sont bien souvent moqués, étiquetés de doux rêveurs, quand bien même ce rêveur agit, concrétise, quand bien même il y a des effets tangibles, des résultats. Et souvent, ces bisounours et leurs projets ne sont même pas évoqués.
Nous nous sommes donc interrogés, Viciss et moi-même, sur ce « délit » de la bonne intention, sur ce danger d’être altruiste. On s’est demandé finalement « qui veut la peau des bisounours ? ». Pour comprendre l’usage du mot bisounours, on a élaboré un concept-outils afin de décrire cette attitude qui consiste à voir la bonne intention comme une faiblesse ou un danger : le brutalisme. Loin de nous l’idée de nous engluer dans un binarisme stérile et déformant, encore moins de créer des étiquettes où les uns seraient « bisounours », les autres « brutalistes » en jouant sur des -isme. Le brutalisme désigne un cadre à certains préjugés et prêt-à-pensé, non imputable à la personne elle-même, mais plutôt à des schèmes qu’elle reproduit. Il n’est nullement question non plus de dénier l’histoire et le corps en nous engouffrant dans une méthode structuraliste où des modèles de pensées se substitueraient à l’histoire singulière de chacun. Nous serions dès lors l’arroseur arrosé. Les concepts que nous évoquons là doivent être conçus comme des outils en vue de l’action ou pour éviter des dérives. Il ne s’agit pas d’instituer un édifice descriptif et définitif, qui pour le coup serait un retour au rigide.
Nous avons écrit un article sur les bisounours et le brutalisme, que vous trouverez ici.
Retenons sommairement les grands traits du brutalisme, traits qui permettent de mieux l’appréhender, mais aussi de l’éviter en s’assurant de ne pas reproduire à notre tour les mêmes schèmes :
- La guerre perpétuelle: dans cette posture brutaliste, le monde est un vaste champ de bataille. Ces guerres se font par des stratégies de communication et par diverses manipulations sur les individus et les groupes. Le brutalisme est une nouvelle forme d’un machiavélisme vulgaire et difforme dans toutes les sphères de la société, ce qui a pour conséquence des violences concrètes ou symboliques.
- La société du spectacle: exister consiste à se faire voir et entendre avec force, mais tout est dans l’apparence et dans le jeu des représentations. Il s’agit de faire du bruit, faire du buzz qu’importe le fond.
- La réussite: la seule visée est la réussite, qui n’est rien de moins qu’une course aux privilèges et qui repose sur la chimère de la croissance infinie, de l’accumulation matérielle permanente, de la reconduction de l’être à l’avoir. La réussite est une victoire sur l’autre, une prise de pouvoir ou de territoire envers et contre tous.
- L’ambition: la valeur pour viser cette réussite est l’ambition, l’ambition est devenue la plus haute qualité de notre société. Mais par-là, que faut-il entendre ? L’ambition se définit dans ce cadre par la témérité du soldat et son potentiel de conquête d’un territoire qu’on lui ordonne implicitement d’envahir (car oui, l’ambition n’est pas interne en cela que les objectifs sont donnés de l’extérieur, par des régulateurs incitatifs).
On s’interroge donc sur ces attitudes. On s’imagine souvent que les opinions des uns et des autres sur tel ou tel sujet relèveraient d’une sensibilité politique, droite/gauche, ou d’une adhésion idéologique ou religieuse. C’est là la partie émergée de l’iceberg. Les opinions et attitudes découlent plutôt de conceptions plus profondes, telles que les croyances et conceptions anthropologiques. Et la conception dominante, du moins dominante dans les médias, et qui s’inscrit dans le monde professionnel, est celle de l’homme-loup : « l’homme est un loup pour l’homme », formule de Plaute reprise par Hobbes. Autrement dit, l’autre est un potentiel adversaire, un ennemi, un rival, un concurrent.
Nous avons évoqué cela dans de précédents articles et dans une vidéo sur le syndrome du grand méchant forgé par Georges Gerbner.
Les médias nous renvoient une certaine image du monde, et quand cette image s’uniformise selon les modalités du brutalisme, de l’homme-loup, de la régression, notre vision est déformée.
Le hacker social essaye donc de mettre des mots, de donner des clefs, d’élargir une vision souvent trop restreinte de la réalité.
Et pour résumer ?
Cette re-introduction dessine un paysage, et comme tout paysage on ne saurait embrasser tous les détails. À chacun désormais, avec sa propre singularité, de s’y investir.
Pour résumer les différents points évoqués, le hacking social est tout à la fois :
- Une réflexion sur les rapports sociaux, sur les normes, préjugés et stéréotypes.
- Une sémiotique, une interrogation des messages redondants dans les médias et des fictions de toutes sortes (comme la mythologie publicitaire que l’on tentera de développer prochainement)
- Une élaboration d’outils qui vise à débrider les rapports et à court-circuiter des processus ou des rapports nuisibles pour l’épanouissement individuel et collectif.
- Un effort sans cesse renouvelé de créer des passerelles, parfois des refuges, des environnements propices au partage.
Tout cela avec humour, jeu, flow. Jamais dans l’attaque, jamais dans l’imposition ; mais dans l’invitation et la proposition. Non selon une idéologie, ou une pensée de marbre, mais avec une pensée plastique, ouverte, et respectueuse des personnes, de leur histoire et de leur singularité.
Le hacking social n’est pas un mouvement, avec des codes précis et fermés: appropriez-le-vous, dans le respect d’autrui et en évitant toute dérive.
Des petites choses peuvent faire beaucoup de mal, beaucoup de tort ; mais inversement, de petites choses peuvent vraiment faire la différence dans le bon sens : un geste, un mot, une attitude…
Ne tombons surtout pas dans un déterminisme social ou un fatalisme sociologique, nous sommes orientés par des déterminants, nous sommes influençables, oui, mais de la même manière nous sommes aussi des déterminants.
Alors, « just do it ».
P.S de BB, voix de l’audio en début d’article :

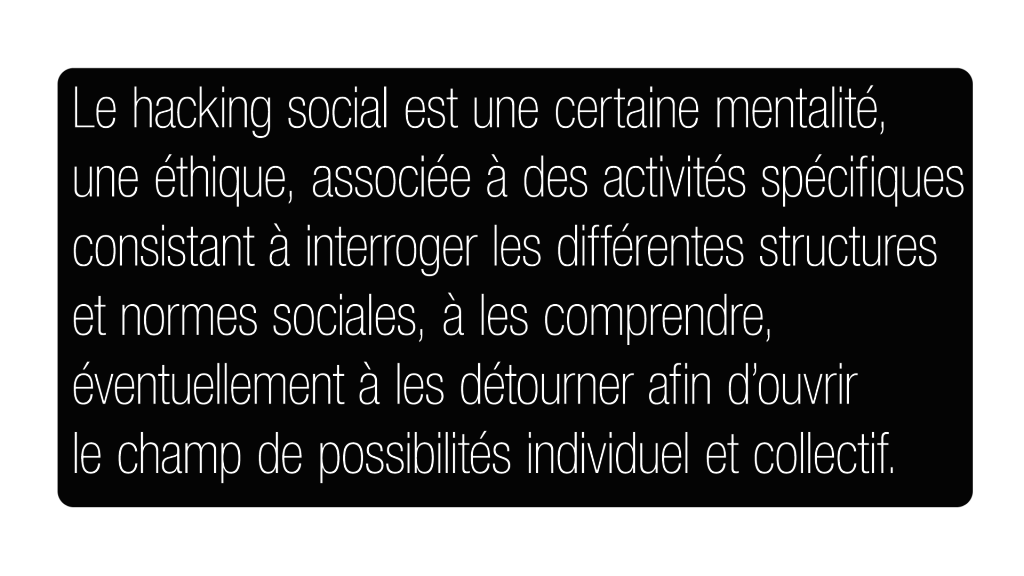






J’ai une approche un peu différente. Plutôt que d’expliquer avec des mots simples ce qu’est le Hacking Social, je préfère parler des hackers sociaux.
En général, je décris le hacker social comme une personne curieuse, dotée du sens de l’observation et bidouilleur à ses heures.
Le hacker social se doit aussi d’être… social, capable de partager sa connaissance; mais avant tout il doit être capable de se remettre en question.
Bref, un hacker social est une personne assez détachée, mais qui porte un regard critique sur tout ce qui l’entoure, capable d’aller au fond des choses, ne s’arrêtant jamais aux apparences. Il n’est pas obligatoire d’avoir fait de grandes études pour devenir un hacker social, tout le monde peut le faire.
Pour ce qui est de la curiosité, la preuve assez facile à trouver se situe… sur le forum! Dans l’onglet « Présentation ». Je râle souvent lorsqu’un nouveau venu se trouve être un(e) étudiant(e) ; mais c’est uniquement pour la forme ; au contraire, je ne peux que me réjouir de voir des étudiants s’intéresser à ce qu’ils font et/ou à d’autres centres d’intérêts. Certains sont dans un cursus proche du HS – Ô Pomme, pourquoi m’as-tu brisé le coeur??? – d’autres en sont assez éloignés, mais tous se sont inscrits par curiosité et soif de savoir…
Bref, je n’ai qu’une chose à dire : SOYEZ CURIEUX!
PS : Ça faisait longtemps que tu n’avais pas écrit un article, Gull. Ça ne fait pas trop mal aux doigts de taper sur un clavier? 😉 D’un autre côté j’espère que tu n’utilises pas ta cagoule lorsque tu écris…
Ciel! C’est donc ça! En fait Viciss écrit avec ta cagoule, ça explique les fautes! 🙂
Très belle approche que de partir du hacker.
C’est effectivement dans l’attitude, la curiosité, et le goût de bidouiller que l’on trouve les grands traits généraux du hacker social.
Se remettre en question est un trait fondamental. La conviction ne doit pas se substituer à la responsabilité, c’est d’autant plus important quand on s’adonne à cette activité de bidouilleur social.
Nul besoin d’un diplôme, d’un parcours universitaire, chacun pouvant s’adonner à ces réflexions ou activités quelque soit sa singularité, sa situation, sa condition.
J’ajouterai à ce portrait une certaine inclination à l’altruisme (ne pas écraser l’autre, se sentir concerné), et une attention particulière, un effort, à ne pas tomber dans le ressentiment. Et sur le forum, il semble même que certain pratique et propage l’art du mignon 😉
Réponse au PS (non, ce n’est pas une réponse au Parti socialiste) : Si, je souffre, mais pas des doigts ; je souffre ne pouvoir écrire davantage 🙂 Mais je devrais pouvoir, je l’espère, publier un peu plus entre deux épisodes, car j’ai la chance d’avoir retrouvé le droit d’usage de mon temps, du moins provisoirement.
Viciss, bien heureusement, ne porte pas ma cagoule, et je ne le lui souhaite pas, surtout après l’avoir moi-même porté plusieurs heures, ce ne seront pas ses yeux qui seront gênés, mais bien son nez ! Diantre, quel horreur !
« on ne peut pas, seul contre tous, changer le monde »
Quel pessimisme, on peut quand même essayer non ? ^^
Les structures accidentelles sont certes moins nuisibles que les autres, mais n’y a-t-il donc jamais de phénomène social nuisible qui intervienne entre amis ou dans la famille ? Des automatismes que nos proches peuvent inconsciemment reproduire hors de leurs structures relationnelles ? (les fameuses déformations professionnelles par exemple, ou bien quelques idées brutalistes qui ressortent dans des contextes privés)
Mais bon, si je commente c’est surtout pour apporter la pierre de mes cours de prépa à l’édifice de cet article, à propos du Kaizen. Ce n’est pas une « philosophie » japonaise, c’est juste un concept de management toyotiste. Attention, je cite dans le détail le powerpoint de mon cours de management :
« LES 10 ÉTATS D’ESPRIT « KAIZEN » :
1. Abandonner les idées fixes, refuser l’état actuel des choses
2. Au lieu d’expliquer ce que l’on ne peut pas faire, réfléchir comment faire
3. Réaliser aussitôt les bonnes propositions d’amélioration
4. Ne pas chercher la perfection, gagner 10% dès maintenant !
5. Corriger immédiatement l’erreur sur place
6. Trouver les idées dans la difficulté
7. Chercher la cause réelle, et chercher ensuite la solution
8. Prendre en compte les idées de 10 personnes au lieu d’attendre l’idée géniale d’une seule
9. Essayer et ensuite valider
10. L’amélioration est infinie »
Dans le toyotisme, ça s’applique à divers domaines de l’entreprise, notamment :
opérations inutiles (du processus de production), stocks, attente, transports (de ce qu’on produit), mouvements (du salarié, mais ce ne sont pas les mouvement genre « aller à la machine à café », mais plutôt « devoir faire 20 mètres à chaque fois qu’on a besoin d’un outil »), sur-production, corrections à effectuer sur la marchandise.
Mais ces 10 points, c’est tellement général que ça pourrait même partiellement s’appliquer au hacking social ^^
La partie du kaizen et du toyotisme que le lean management a nettement moins conservée, c’est la conception de la hiérarchie et de l’aliénation générée par les tâches à effectuer, qui est elle aussi améliorée :
« Rotation des postes ; Élargissement des tâches ; Enrichissement des tâches ; Groupes semi-autonomes ; Résolution des problèmes par les hommes de terrain ; Boîtes à idées »
Le toyotisme étant pensé comme une amélioration cohérente du fordisme, tant humainement que financièrement, le Lean n’est qu’une contre-façon incomplète et incohérente : en poussant l’idée d’amélioration jusqu’au bout, il est totalement logique d’améliorer aussi la hiérarchie, par exemple en supprimant les postes inutiles, comme les sous-chefs et les managers, et d’améliorer les conditions de travail le plus possible pour améliorer l’efficacité du travail.
La création et l’application du « lean management » occidental est donc le fruit d’incompétents, et (sauf si la stratégie est de jeter les employés comme le ferait un célibataire avec ses kleenex) c’est voué à l’échec ou à un changement de politique de management à plus ou moins long terme.
Bonjour,
Pour la phrase « on ne peut pas, seul contre tous, changer le monde », ce n’est nullement du pessimisme. Bien au contraire. Quand on se donne des objectifs irréalisables, on se trouve bien vite dans une impasse. De là peut naître la frustration, le découragement, un abandon, ou une radicalité. Et j’ai envie d’ajouter, qui pourrait être assez fou pour imposer son propre changement au monde? Changer le monde, très bien, mais vers quoi?
Cette phrase n’est pas à comprendre comme un renoncement à l’action , mais au contraire comme une condition à l’action et au changement: « que puis-je faire, concrètement? » « Que puis-je faire seul, ou à plusieurs? » « Je ne peux pas changer le monde, mais je peux contribuer à des changements concrets, ici et maintenant? ».
Pour les structures accidentelles, nous ne disons pas qu’il n’y aurait pas là un travail à faire. Il s’agit juste de bien distinguer deux « terrains d’action », où l’un est plus périlleux que l’autre, car dans les structures accidentelles on en vient bien vite à toucher la personne. Ce n’est sans doute pas propre au hacking social. Par contre, les automatismes dont tu parles, là il y a sujets à réflexion, et c’est ce que nous n’hésitons pas à faire 😉
Par philosophie japonaise à propos du Kaizen, nous voulons parler d’un certain mode de pensée, qui ne se réduit pas au management. On trouve d’ailleurs ce mode de pensée du « kaizen » en dehors du management, mais appliqué concrètement dans le quotidien dans tous les domaines (il y a d’ailleurs un magazine français qui porte ce nom, et qui présente l’esprit du kaizen comme une philosophie de vie).
Merci d’avoir partagé avec nous tes cours de prépa 🙂
Cette petite réintroduction est très sympas
C’est important ce que vous faites, ça fait presque un an que je vous suis et vous m’avez fait prendre d’affection pour la Sociologie.
Ça m’a motivé à reprendre mes études, pour ne plus subir les humeurs de mon « manager sadique » 🙂
Je poste pas de commentaires d’habitude mais j’ai trouvé ça important de vous le partager pour que vous vous rendiez compte que ce que vous faites à un impact.
Continuez c’est super.
[…] des situations de groupes réellement constitués (par exemple : classes d'élèves ; cf. 2. Réintroduction au Hacking social. Profitons de cette rentrée, de ce renouveau annuel, plein de projets et de volonté, pour revenir […]