On a vu précédemment que la CIM et le DSM avaient inclus le trouble du jeu dans leurs classifications, notamment parce que c’était une préoccupation assez importante en Asie. Et effectivement, lorsque j’ai fouiné dans les articles de recherches, je trouvais une majorité d’études asiatiques, notamment chinoises : la société chinoise est traditionnellement collectiviste, mais des études tendent à montrer que les nouvelles générations sont plus individualistes1.
Déroulez pour rattraper les épisodes précédents ⬇️
- Comment ne plus être « accro » aux jeux-vidéo…
- Qu’est-ce qui pousse certains à ne faire que jouer aux jeux de leur vie ?
- Jouer pour oublier ?
⚠️ Cet article reprend des études et notions que nous avions déjà abordés, mais comme il s’agit d’un nouvel angle, il y avait besoin de les citer à nouveau : ♦ Le gamer « no-life », un autoritaire ??
En psycho, voici ce qu’on désigne par culture individualiste et collectiviste2, qu’on distingue aussi par leur horizontalité et leur verticalité :
Dans l’individualisme en général, il y a une croyance que chacun est responsable de soi et que l’intérêt de l’individu prévaut sur celui du groupe. Les individus donnent la priorité à leurs objectifs personnels par rapport aux objectifs de leur groupe et ils se comportent principalement sur la base de leurs attitudes plutôt que sur les normes de leurs groupes. L’individualisme caractérise les sociétés où l’indépendance, l’autonomie, la différenciation sociale, la compétition, l’épanouissement et le bien-être personnel sont au centre (Triandis, 2001).
Dans l’individualisme vertical (c’est-à-dire valorisant plus la hiérarchie), les individus adhèrent aux inégalités de statuts, valorisent la comparaison sociale, la compétition, la recherche de l’intérêt personnel et le pouvoir (de domination) sont valorisés. Et si vous nous suivez, oui, effectivement c’est très proche d’une vision d’un jeu à somme nulle, de pensées d’autoritaires dominateurs (sdo).
Dans l’individualisme horizontal, les individus sont considérés comme égaux, et la liberté individuelle de chacun est valorisée.
Dans le collectivisme en général (qui est le plus répandu sur la planète), il y a préoccupation pour les relations et les liens entre les membres du groupe. La personne donne la priorité aux objectifs du groupe, car l’intérêt du groupe prévaut sur celui de l’individu (Hofstede, 2010). Le collectivisme caractérise les sociétés où l’attachement, l’interdépendance, l’intégrité familiale, la loyauté à un groupe, la sociabilité et la coopération sont au centre (Triandis, 2001).
Dans la version verticale du collectivisme (c’est-à-dire valorisant plus la hiérarchie), l’individu est interdépendant du groupe, mais il se caractérise davantage dans la différence de statut et de pouvoir. Il y a adhésion à l’inégalité de statuts entre personnes, mais le sacrifice au profit du groupe reste un point important. La conformité sociale, le respect de l’autorité et l’asymétrie des relations y sont des aspects importants.
Dans le collectivisme horizontal (c’est-à-dire valorisant plus l’égalité entre personnes) l’individu est perçu comme connecté aux autres, il se construit comme étant égal aux autres. L’égalité et le partage y sont des valeurs essentielles.
Est-ce que la Chine étant traditionnellement plus collectiviste, les paniques autour du surjeu sont d’autant plus fortes que le comportement de jeu paraît individualiste, coupé du monde social IRL ? Et qu’en cas de trouble du jeu, l’individu se coupant des groupes sociaux et donc n’accomplissant pas des valeurs importantes pour une société collectiviste, c’est considéré encore plus inquiétant que dans une société individualiste ?
Ou peut-être que c’est tout autre chose : est-ce que les joueurs collectivistes pourraient être plus accrochés au jeu, car celui-ci a des mécaniques collectives et divers sentiments d’obligations sociales liés au groupe ? Devoir être présent pour son équipe, devoir passer plusieurs heures à faire une instance à plusieurs, gérer la guilde, etc. maintiendrait encore plus fort dans le jeu un joueur collectiviste qu’individualiste qui jouerait prioritairement pour lui-même et non le bénéfice du groupe.
Et enfin, peut-être que l’individualisme et le collectivisme ne sont pas du tout des variables pertinentes pour comprendre ni le trouble du jeu ni pourquoi les chercheurs asiatiques s’y intéressent plus.
Alors j’ai regardé si les recherches avaient étudié ceci :
Une étude de Stavropoulos, Frost, Brown et al (2021)3, sur plus de 1000 participants, mesuraient à la fois le trouble du jeu et le collectivisme/individualisme des joueurs. Les chercheurs ont distingué deux profils : ceux aversifs au collectivisme et ceux neutres vis-à-vis de celui-ci. C’est ceux qui étaient aversifs au collectivisme qui avaient des troubles du jeu plus élevés, dont des symptômes de sevrage, de troubles de l’humeur, de mensonges aux proches, etc. Les chercheurs concluent :
« Ceux qui sont moins collectivistes ou moins influencés par les groupes sociaux afficheront des symptômes d’IGD [internet gaming disorder] plus importants et présenteront un profil qui nécessite une intervention différente de celle des joueurs plus collectivistes. Les chercheurs et les cliniciens devraient mettre l’accent sur la valeur d’appartenance à un collectif et de vivre l’égalité avec les autres en matière de santé mentale et d’habitudes de jeu. »
Stavropoulos, Frost, Brown et al (2021) Internet gaming disorder behaviours: a preliminary exploration of individualism and collectivism profiles https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12888-021-03245-8.pdf
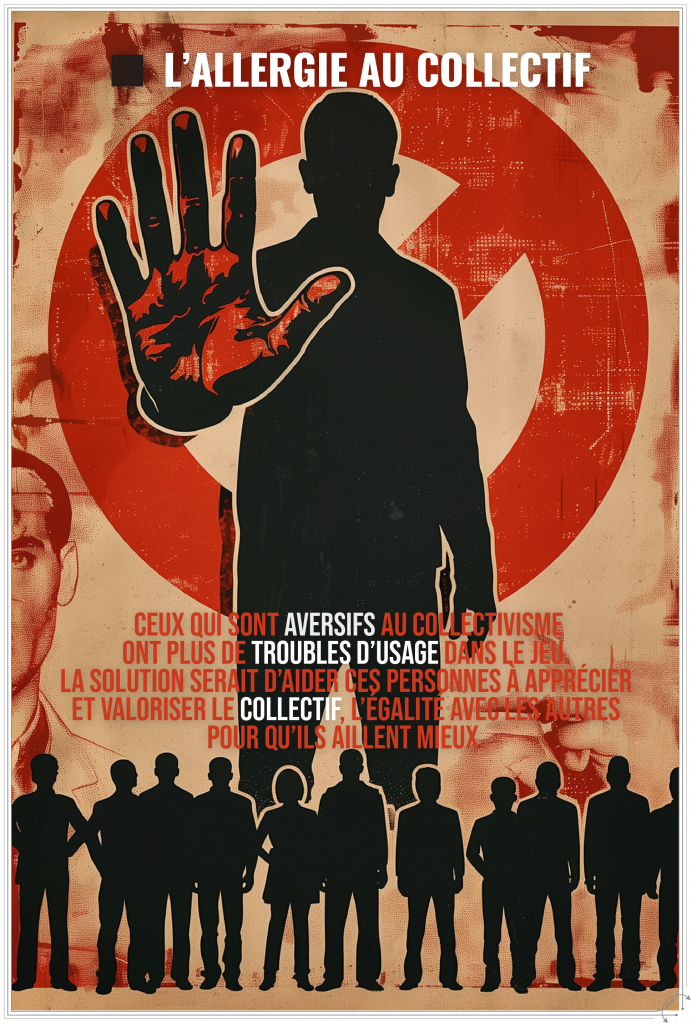
⬛l’allergie au collectif : ceux qui sont aversifs au collectivisme ont plus de troubles d’usage dans le jeu. La solution serait d’aider ces personnes à apprécier et valoriser le collectif, l’égalité avec les autres pour qu’ils aillent mieux.
Une étude4 sur plus de 1000 personnes issues de sociétés multiculturelles confirme encore ce lien entre individualisme et problème de jeu. Les chercheurs ont ici mesuré la dépression, les troubles du jeu et une échelle de collectivisme/individualisme en prenant en compte la verticalité de la culture :
« Les résultats ont démontré que les joueurs présentant simultanément des symptômes de dépression et des penchants individualistes verticaux signalaient des niveaux plus élevés de comportements de jeu à problèmes, sans différence significative entre les sexes. Les résultats obtenus impliquent que les praticiens du monde entier, et en particulier dans les sociétés multiculturelles (par exemple, Australie, États-Unis), devraient prendre en compte les différences culturelles lors de l’élaboration de stratégies de prévention et d’intervention contre les troubles du jeu ».
Dans la même veine, une autre recherche5 montre que les troubles de l’attention associés au trouble du jeu sont liés à un individualisme vertical.
C’est donc l’ancrage dans une vision du monde individualiste vertical, rejetant le collectivisme et l’horizontalité en général, qui poserait problème.
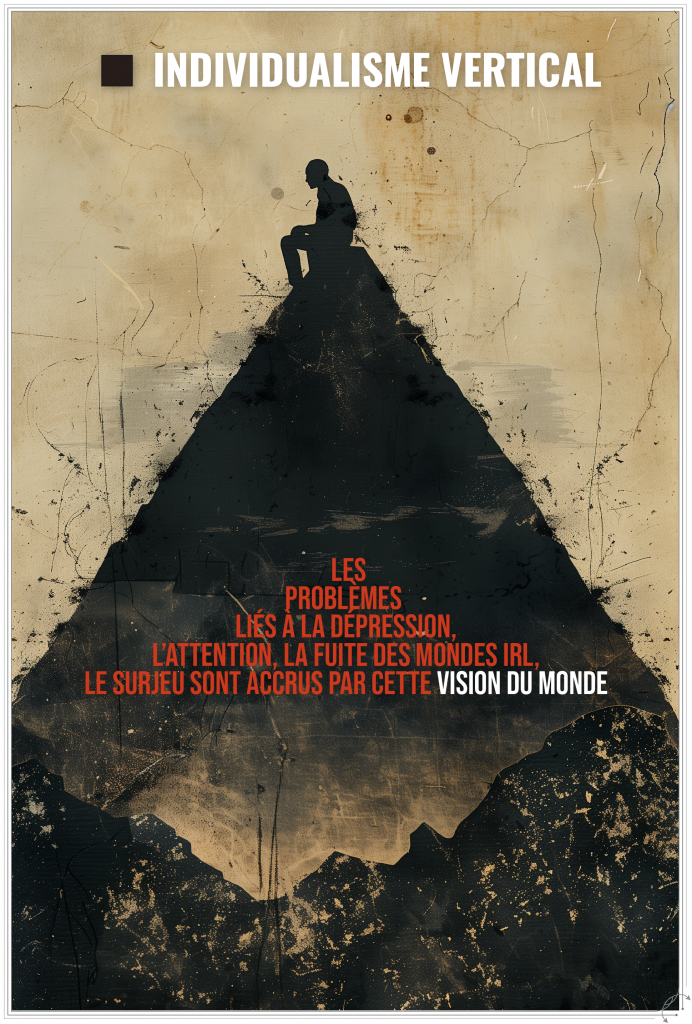
⬛Individualisme vertical : Les problèmes liés à la dépression, l’attention, la fuite des mondes IRL, le surjeu sont accrus par cette vision du monde
Une autre étude6 montre aussi un fort lien entre trouble du jeu, motivation à s’échapper et individualisme.
À ces résultats on pourrait avoir quantité d’hypothèses différentes : peut-être que certains jeux installent culturellement cet individualisme vertical ou renforcent celui préexistant ; peut-être que des joueurs dans une verticalité vont vers certains types de jeu qui renforcent celui-ci ; peut-être que les joueurs sont poussés par des aspects individualistes de la société à choisir des jeux qui l’expriment/le renforcent ; peut-être que les jeux, quelle que soit leur nature, sont pris de façon individualiste verticale par des individus coincés dans cette vision du monde pour des raisons très localisées à leurs environnements sociaux proches ? Et enfin, quel est le rapport à la culture d’un pays ?
Des études sur des surjoueurs, en Chine, par Rao7 vont nous permettre de voir plus facilement toutes ces articulations complexes entre société et comportements, et offriront peut-être même une voie de sortie de ces problèmes. C’est ce qu’on verra la prochaine fois !
La suite : Un camp de traitement pour « l’addiction » à internet ? [AJ5] – Hacking social
Déroulez pour consulter toutes les notes de bas de page et la biblio ↩️
La bibliographie complète est présente ici : Bibliographie [AJV]
1https://www.erudit.org/fr/revues/mi/2013-v17-n4-mi01016/1020670ar.pdf
2Sur la base de Triandis, H. C. (2001). Individualism‑collectivism and personality ; Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3ᵉ éd.). McGraw-Hill.
3 Stavropoulos, Frost, Brown et al (2021) Internet gaming disorder behaviours: a preliminary exploration of individualism and collectivism profiles https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12888-021-03245-8.pdf
4O’Farrell, D. L., Baynes, K.‑L., Pontes, H. M., Griffiths, M. D., & Stavropoulos, V. (2022). Depression and disordered gaming: Does culture matter?https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00231-1
5Stavropoulos, V., Baynes, K.‑L., O’Farrell, D. L., Gomez, R., Mueller, A., Yücel, M., & Griffiths, M. D. (2020). Inattention and disordered gaming: Does culture matter? https://core.ac.uk/download/pdf/286268571.pdf
6Wang, H.-Y., & Cheng, C. (2022). The associations between gaming motivation and Internet gaming disorder: Systematic review and meta‑analysis The Associations Between Gaming Motivation and Internet Gaming Disorder: Systematic Review and Meta-analysis – PMC
7Rao, Y. (2019). From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication. ; Rao, Y. (2015). Coming of Age with Internet Addiction in China: An Ethnographic Study of Institutional Encounters and Subject Formation
